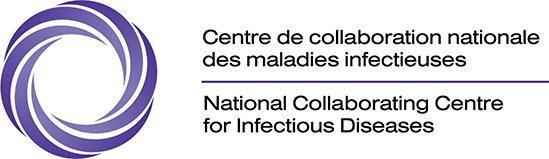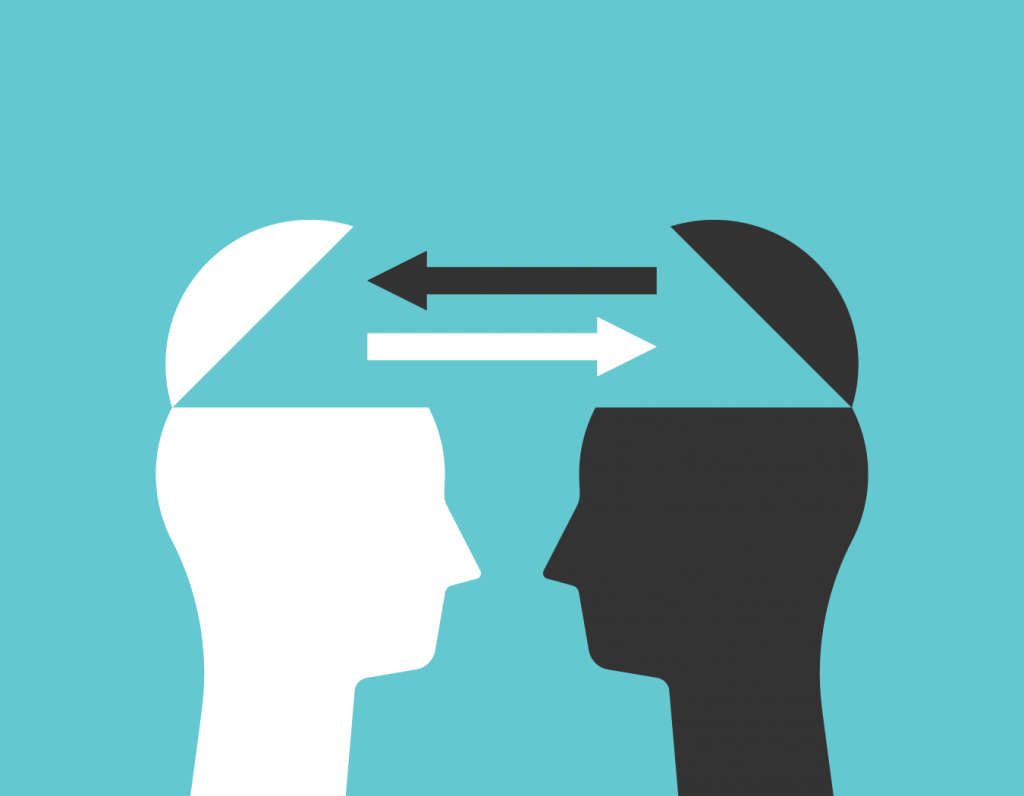
« L’incidence des stratégies de communication et du discours médiatique sur les réactions psychologiques et comportementales à la pandémie de COVID-19 : une étude comparative internationale ».
Depuis le début de la pandémie de COVID‑19, le CCNMI accomplit un travail diligent et pertinent en tant qu’instigateur et partenaire de nombreuses activités relatives au transfert des connaissances. Il collabore notamment, au sein d’une équipe de scientifiques canadiens et étrangers, à l’élaboration de stratégies d’échange du savoir sur le sujet brûlant de la santé psychosociale, dans le but d’informer les décisionnaires de la santé publique à tous les échelons ainsi que la communauté scientifique.
Une approche fondée sur des méthodes mixtes a été retenue pour étudier cette question des plus complexes. D’abord, une enquête populationnelle sera menée dans tous les pays participants sur tout un éventail de questions psychosociales (perceptions, interprétations, conséquences psychologiques, comportements), en tenant compte des différents groupes sociaux, dont les groupes à risque élevé. Ensuite, on procédera à une analyse du discours des autorités, des médias et des contenus socionumériques. Enfin, on effectuera une analyse des réseaux (par. ex. information disséminée par l’OMS, listes de diffusion, réception et usage de l’information, types d’acteurs rejoints) qui permettra de déterminer comment l’information officielle circule entre les niveaux de gouvernement.
Description du projet
Le projet de recherche a reçu une subvention de recherche des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Il est piloté par une équipe multidisciplinaire de l’Université de Sherbrooke dirigée par la Dre Mélissa Généreux, chercheuse principale. Les partenaires et collaborateurs du projet proviennent du Canada, des États-Unis, des Philippines, de Hong Kong, du Brésil, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, de Suisse et de Belgique. Leur but est d’étudier les réactions psychologiques et comportementales à la pandémie dans huit pays, ainsi que l’incidence des stratégies de communication, des nouvelles transmises par les médias traditionnels (grand public) et les médias sociaux et d’autres facteurs de stress et protection.
Résultats de la phase I
La phase I de l’étude comparative internationale a été publiée et réalisée par Léger et ses collaborateurs internationaux, du 29 mai au 12 juin 2020. Le questionnaire comportait un peu plus de 80 questions fermées, avec un temps de réponse de 18 minutes. Ce questionnaire examinait des facteurs tels que le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), le trouble d’anxiété généralisée (TAG), l’épisode de dépression majeure (EDM), les stratégies de gestion du stress (consommation d’alcool et de cannabis et activité physique), la menace perçue, l’isolement ou la quarantaine, les pertes financières, la stigmatisation, la confiance, les sources d’information et le sentiment de cohérence. Un échantillon représentatif de 8 806 personnes a participé à l’enquête : 1 501 adultes au Canada et 7 305 personnes de sept autres pays (tableau 1).
Table 1. Répartition de l’échantillon selon le nombre de répondants
| Canada | 1 501 |
| États-Unis | 1 065 |
| Angleterre | 1 041 |
| Belgique | 1 015 |
| Suisse | 1 002 |
| Hong Kong | 1 140 |
| Philippines | 1 041 |
| Nouvelle-Zélande | 1 001 |
| Total | 8 806 |
Résultats
Les tableaux 2 à 6 présentent les résultats préliminaires de l’enquête, une analyse comparative des réponses des participants du Canada avec celles des participants d’autres pays.
Table 2. La réponse psychologique (ou les problèmes de santé mentale) de la population adulte, près de trois mois après le début de la pandémie COVID-19 (déclarée le 11 mars 2020 par l’OMS); les réponses du Canada et de tous les autres pays
| Problèmes de santé mentale | Total (n = 8 806) | Canada (n = 1 501) | Autres pays et régions (n = 7 305) |
|---|---|---|---|
| Trouble de stress post-traumatique probable, ou TSPT (PC-PTSD-5 ≥3)1 | 21,6 % | 19,2 % | 22,2 % |
| Trouble d’anxiété généralisée probable, ou TAG (GAD-7 ≥10)2 | 21,0 % | 19,6 % | 21,3 % |
| Épisode de dépression majeure (EDM ) probable (PHQ-9 ≥10)3 | 25,5 % | 25,5 % | 25,4 % |
établissements de soins primaires. Les personnes interrogées devaient répondre par oui ou non à cinq questions sur la manière dont la pandémie de COVID-19 les a affectées au cours du mois écoulé. Les personnes qui ont répondu « oui » à au moins trois des cinq questions ont été considérées comme ayant un trouble de stress post-traumatique (TSPT) probable.
2 Le GAD-7 (7 points) est basé sur les critères de diagnostic du trouble d’anxiété généralisée (TAG) décrit dans le DSM-IV. Un score composite compris entre 0 et 21 est possible. Un score de 10 ou plus indique un TAG probable qui doit être évalué plus en détail par un clinicien.
3 Le PHQ-9 (9 points) est basé sur les critères de diagnostic d’un épisode de dépression majeure (EDM) probable décrit dans le DSM-IV. Un score composite compris entre 0 et 27 est possible. Un score de 10 ou plus indique un EMD probable qui doit être évalué par un clinicien.
Table 3. La réponse comportementale (ou les stratégies de gestion du stress) de la population adulte, près de trois mois après le début de la pandémie COVID-19 (déclarée le 11 mars 2020 par l’OMS); les réponses du Canada et de tous les autres pays.
| Stratégies de gestion du stress* | Total excluant Hong Kong (n = 7 666) | Canada (n = 1 501) | Autres pays et régions (n = 6 165) |
|---|---|---|---|
| Consommation d’alcool | 30,3 % | 36,6 % | 28,8 % |
| Consommation de cannabis | 10,9 % | 15,6 % | 9,8 % |
| Activité physique | 66,8 % | 64,3 % | 64,9 % |
Table 4. Réponse psychologique en fonction des caractéristiques sociodémographiques, Canada (n=1 501)
| Caractéristiques sociodémographiques | Trouble d’anxiété généralisée probable (%) | Épisode probable de dépression majeure |
|---|---|---|
| Sexe | ||
| Femmes | 23,2 % | 28,4 % |
| Hommes | 15,4 % | 22,0 % |
| Âge | ||
| 18 – 44 ans | 27,3 % | 34,0 % |
| 45 – 64 ans | 16,0 % | 21,7 % |
| 65 ans et plus | 9,7 % | 14,5 % |
| Enfants à domicile | ||
| Oui | 24,6 % | 27,4 % |
| Non | 17,7 % | 24,8 % |
| Travailleur essentiel | ||
| Oui | 21,3 % | 31,9 % |
| Non | 18,8 % | 23,5 % |
Table 5. Fréquence des facteurs de stress psychologique, le Canada par rapport aux autres pays participants
| Facteurs de stress | Total (n = 8 806) | Canada (n = 1 501) | Autres pays et régions (n = 7 305) | Impact sur le TAG (Canada) | Impact sur les EDM (Canada) |
|---|---|---|---|---|---|
| La menace pour soimême perçue comme élevée | 25,7 %1 | 21,0 % | 26,9 %1 | +51 % | +67 % |
| La menace pour la famille perçue comme élevée | 28,2 %1 | 25,9 % | 28,8 %1 | +68 % | +83 % |
| La menace pour le pays est perçue comme élevée | 47,4 %1 | 44,7 % | 48,1 %1 | +67 % | +38 % |
| La menace pour le monde est perçue comme élevée | 70,2 %1 | 70,6 % | 70,1 %1 | +85 % | +27 % |
| Auto-isolement ou quarantaine | 61,9 %2 | 74,9 % | 58,6 %2 | +54 % | +56 % |
| Pertes financières | 55,3 %2 | 53,1 % | 55,8 %2 | +66 % | +49 % |
| Victime de stigmatisation | 16,6 %2 | 10,6 % | 18,0 %2 | +66 % | +112 % |
2Excluant la Nouvelle-Zélande
Table 6. Fréquence des facteurs de protection, le Canada par rapport aux autres pays participants
| Facteurs de protection | Total (n = 8 806) | Canada (n = 1 501) | Autres pays et régions (n = 7 305) | Impact sur le TAG (Canada) | Impact sur les EDM (Canada) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort sentiment de cohérence (SOC-3 ≥4) | 30,1 % | 36,9 % | 28,7 % | -223 % | -223 % |
| Niveau élevé de confiance dans les organisations nationales de santé (9 ou 10/10) | 31,5 % | 35,9 % | 30,6 % | -61 % | -51 % |
| Niveau élevé de confiance dans les experts de santé (9 ou 10/10) | 41,4 % | 47,2 % | 40,2 % | -61 % | -42 % |
Interprétation : Un sentiment de cohérence (SOC) est la capacité des gens à comprendre, à gérer et à donner un sens à un événement. Plus le sentiment de cohérence est fort, plus la capacité à faire face à l’adversité est forte. Cette étude révèle que dans l’ensemble (c.-à-d., parmi les huit pays), les personnes ayant un fort sentiment de cohérence sont trois fois moins susceptibles (soit environ -200 %) d’avoir un TAG ou un EDM probable que celles qui ont un sentiment de cohérence plus faible. De tous les facteurs examinés dans cette étude (menace perçue, isolement/quarantaine, pertes financières, stigmatisation, confiance), c’est de loin le facteur qui influe le plus fortement sur la santé psychologique en période de pandémie.
- TAG probable : 8,1 % parmi les personnes ayant un sentiment de cohérence fort contre 26,2 % parmi celles ayant un sentiment de cohérence faible (Canada; n = 1 501)
- EDM <probable : 10,6 % parmi les personnes ayant un sentiment de cohérence fort contre 34,2 % parmi celles ayant un sentiment de cohérence faible (Canada; n = 1 501)
Résultats de l’étude pilote
Afin de vérifier la validité et la fiabilité des instruments d’enquête, les chercheurs de l’Université de Sherbrooke ont mené une enquête pilote au Canada. Six cents personnes (300 au Québec et 300 hors Québec) ont participé à l’enquête entre le 8 avril et le 11 avril 2020.
Les résultats préliminaires figurent dans le tableau 1.
| Québec | Reste du Canada | |
|---|---|---|
| TSPT (trouble de stress post-traumatique) | 18,8 % | 27,5 % |
| Trouble d’anxiété généralisée | 14,2 % | 28,8 % |
| Adhésion à l’isolement volontaire ou obligatoire | 88,6 % | 72,8 % |
| Confiance en la capacité des autorités à gérer la pandémie | 49,6 % | 26,8 % |
| Sentiment de détenir l’information nécessaire pour bien comprendre le phénomène du coronavirus. | 83,7 % | 60,8 % |
D’après les résultats de l’enquête, les répondants du Québec ont manifesté un degré de confiance plus élevé que ceux du reste du Canada en la capacité des autorités de gérer la pandémie. En outre, les Québécois ont dit détenir l’information nécessaire pour bien comprendre le phénomène de la pandémie; ils étaient donc moins enclins que les répondants des autres provinces à souffrir de trouble de stress post-traumatique et de trouble d’anxiété généralisée, entre autres réactions aux stresseurs psychosociaux.