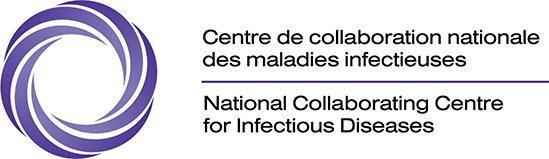Ne pas voir l’audio?
ÉCOUTER ICI
TRANSCRIPTION
Au Canada, les plus récentes éclosions de syphilis ont surtout touché les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Dans les provinces de l’Ouest, une nouvelle tendance s’est également dégagée ces dernières années : les taux sont plus élevés qu’avant parmi les hétérosexuels, en particulier chez les femmes. Winnipeg est une des villes des provinces de l’Ouest particulièrement touchée par les épidémies; les cas de syphilis infectieuse y ont plus que doublé en 2018. Ces infections semblent être associées à un manque de logement adéquat et à la toxicomanie, notamment à la méthamphétamine. On sait également qu’un nombre disproportionné de ces femmes sont autochtones.
Dans cette conversation, la première d’une série sur la syphilis produite par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, et publiés en partenariat avec le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, nous rencontrons Laverne Gervais, coordonnatrice de programme auprès de l’organisme Ka Ni Kanichihk et éducatrice en santé sexuelle. Elle aborde ici les circonstances auxquelles peuvent être confrontées les femmes autochtones, les facteurs de risque correspondants et les moyens par lesquels la santé publique peut les aider davantage. Elle s’est entretenue avec Jami Neufeld du CCNMI.
Jami Neufeld : Que doivent savoir et comprendre les prestataires de soins primaires et le personnel de santé publique à propos des risques de syphilis chez les femmes autochtones dans les communautés avec lesquelles vous travaillez?
Laverne Gervais : En général, il y a beaucoup de stigmatisation autour des infections sexuellement transmissibles. Juste le fait d’être une jeune femme autochtone entraîne déjà une stigmatisation, du racisme et de la discrimination en général. En plus de cela, se présenter dans un établissement de santé et devoir surmonter cette stigmatisation, ce n’est pas garanti que la visite se fera. Donc, essentiellement, les personnes ont le sentiment qu’il y a autant de racisme à l’intérieur de l’établissement de santé qu’à l’extérieur. Donc, en fin de compte, parfois les personnes hésitent. Elles se demandent si ça vaut la peine d’aller chercher des soins alors qu’elles seront mal traitées de toute façon. Elles mettent ça de côté. Ou encore, elles préfèrent simplement ne pas savoir. Elles se disent : « pourquoi avoir mon nom inscrit officiellement sur une liste, ou attacher officiellement mon identité à cette maladie? » Je pense aux nombreuses conversations que j’ai eues avec de jeunes femmes, par exemple; c’est un autre préjugé qui s’ajoute à leur bagage, un autre sentiment de honte. Elles préfèrent donc ne pas le savoir. Cette façon de voir les choses n’est sûrement pas le moyen le plus efficace de promouvoir les soins de santé.
De nombreuses jeunes femmes sont très actives pour leurs propres soins de santé, mais si on était à leur place et qu’on vivait l’expérience qu’elles ont en accédant aux services, on comprendrait. C’est assez dissuasif pour simplement dire : « oublie ça! » Donc, non seulement la personne est stigmatisée pour avoir une vie sexuelle active, et potentiellement tout ce que cela entraîne, tous ces stéréotypes très négatifs autour de l’identité féminine, on la juge également pour avoir utilisé ou non la contraception. Elle risque également d’être jugée en raison de la consommation de drogues, si c’est ainsi que la maladie s’est transmise, car la syphilis et les drogues par voie intraveineuse sont désormais étroitement associées. Il y a tellement de choses auxquelles les femmes doivent penser, sur lesquelles elles sont jugées lorsqu’elles entrent dans une clinique, particulièrement chez un médecin.
Alors, quand je pense à l’éducation qui existe réellement, et au manque d’éducation… dans mon travail, je vois aussi des jeunes qui ne sont pas engagés dans des systèmes éducatifs, et en général, c’est là que l’éducation se fait, n’est-ce pas? Les jeunes vont à l’école et on les éduque sur ces choses-là. Mais si, par exemple, vous avez beaucoup de jeunes qui ont des problèmes ou doivent composer avec les services à l’enfance, ou d’autres qui ne vont tout simplement pas à l’école parce que les écoles ne sont pas toujours des endroits sûrs – la question est de savoir comment on peut alors les éduquer sur ces questions.
Ils ne reçoivent peut-être pas toute l’information dont ils ont besoin. On trouve de bonnes initiatives chez les pairs qui font de l’éducation et s’échangent de l’information. Et cela doit être encouragé. C’est l’un des meilleurs moyens d’entrer en contact avec les jeunes. C’est donc un autre obstacle à la promotion de la santé en procréation, fondée sur la justice, une approche de santé sexuelle pour répondre à leurs besoins.
Neufeld : Selon vous, quels sont les moyens de soutenir les femmes autochtones atteintes de syphilis ou qui risquent de le devenir?
Gervais : Les femmes autochtones savent ce qu’elles veulent. Vous savez, elles ont leur propre système. Elles connaissent leur corps. Nous savons ce dont nous avons besoin et ce que respectons… le fait d’aller chez le médecin, c’est déjà un engagement envers sa santé… Nous sommes également capables de prendre soin de nous et nous avons nos propres idées et objectifs pour nos soins de santé. Ça, c’est un premier point. Alors, quand les femmes vont chez le médecin, elles doivent être traitées avec respect. Elles sont éduquées, nous sommes éduquées, nous sommes intelligentes, nous avons nos propres manières culturelles. Nous apportons aussi nos propres méthodes de guérison; quand nous allons voir un médecin, c’est pour obtenir un soutien supplémentaire. C’est comme ça dans de nombreux cas : pour obtenir un soutien supplémentaire.
Les personnes se trouvent dans des situations de vulnérabilité et méritent d’être traitées avec un minimum de sécurité et de respect. Nous ne sommes pas des moins que rien, dénuées de sensibilité. Ce que je veux dire par là, c’est que j’ai entendu trop d’histoires de femmes qui ont eu l’impression qu’on se moquait d’elles et qu’on les méprisait, comme si elles n’avaient aucun sentiment. On ne montrait aucune sensibilité à leur égard, envers leur souffrance, littéralement. Vous savez, ces gens-là sont là pour donner un service de santé. Si les femmes se présentent en clinique, c’est déjà un bon point. Elles franchissent la porte, c’est une bonne chose. Vous savez, il faut les traiter comme des personnes qui prennent soin de leur santé; parlez avec elles, de leurs idées sur leurs propres soins de santé. À mon avis, cela serait positif, en particulier pour les jeunes femmes autochtones qui, vous le savez, doivent surmonter beaucoup de préjugés dans leur vie de tous les jours, et de violence aussi. Changer notre approche de stigmatisation du sexe, et de stigmatisation l’utilisation de substances…
Par exemple, si nous pouvions nous débarrasser de la stigmatisation, nous pourrions avoir une meilleure chance de contrôler ces maladies. Il existe des pratiques et des stratégies générales de réduction des méfaits, mais le plus important est que le système évolue en ce qui concerne la stigmatisation de ces maladies, la consommation de substances, etc. C’est ce qui doit se passer pour que ces taux puissent vraiment baisser. Pour répondre à la question sur le soutien à apporter aux jeunes femmes autochtones ou aux femmes autochtones, selon mon expérience avec le VIH, l’un des problèmes a été le manque d’accès aux méthodes de guérison traditionnelles ou autochtones. Comme je le disais plus tôt, cette autre méthode, cette méthode occidentale est vraiment un complément pour soutenir et répondre aux besoins en santé.
Mais souvent, on n’a pas assez de soutien pour permettre aux gens d’avoir accès aux méthodes autochtones. Encore une fois, il s’agit de relations, de création de liens, apprendre à connaître les différentes personnes de notre communauté et à respecter les règles, leurs méthodes de guérison. Ce sont des méthodes utiles qu’on utilise depuis des siècles pour améliorer la santé. C’est une partie importante de notre processus de guérison. Malheureusement, il arrive souvent que les personnes vivent sans lien avec leur culture et leur identité; elles n’ont pas de sentiment d’appartenance. Pour notre organisme, c’est vraiment important d’être là. Mais c’est aussi ce que demandent certaines de nos jeunes femmes : non seulement d’être traitées avec respect, mais également d’avoir accès aux ressources de manière à satisfaire leurs besoins, là où elles sont. Là où elles se sentent en sécurité et également bien accueillies.
Neufeld : Alors, quel rôle votre organisation ou d’autres organisations autochtones peuvent-elles jouer dans la prestation de services à la communauté
Gervais : En quelque sorte, il faut s’assurer d’avoir une place aux tables de prise de décision, aux tables de politique, aux tables de santé. La culture fait partie intégrante de nos activités. C’est une part importante de qui nous sommes. Nous examinons la santé sous un angle « holistique »; c’est le terme qu’on utilise, n’est-ce pas? Il n’y a pas que l’aspect physique qui compte. Dans le cas des ITSS, on a tendance à adopter une approche de santé sur le plan physique uniquement. Il existe également des composantes mentales, spirituelles et émotionnelles qui sont souvent exclues de la santé. Il y a des facteurs de santé qui sont d’ordre émotionnel ou mental,… mais tout est séparé. Nous essayons dans notre travail de réunir tous ces aspects, y compris en particulier les aspects spirituels, peu importe la manière dont on définit le spirituel.
Pour nous, la spiritualité est un élément important des relations et du développement de relations avec la communauté. Chez nous, nous n’avons pas de patients; c’est une expression très courante ou une référence aux personnes qui entrent dans un établissement médical. Nous avons des participants. Et plus important encore, nous considérons les personnes également comme des parents, parfois au vrai sens du terme, d’autres fois, simplement parce qu’il y a une compréhension mutuelle. La façon de voir autochtone, c’est que ces personnes sont nos parents. Oui, l’approche en santé est trop individualiste.
Dans les faits, il s’agit d’une communauté où les personnes prennent soin de l’une de l’autre, tout en se responsabilisant. Et c’est ce que font plusieurs de nos organismes autochtones ici à Winnipeg, comme nous. Simplement créer des espaces sûrs pour que nos gens viennent ici, se réunissent et aient un lieu pour faire entendre leur voix, leurs expériences, être reconnues et respectées.
Neufeld : Que devraient ou pourraient alors faire le personnel de santé publique et les prestataires de soins de santé primaires pour collaborer avec des organismes comme le vôtre afin de ralentir ou d’arrêter la progression de la syphilis?
Gervais : La Commission de vérité et réconciliation du Canada a lancé une série d’appels à l’action. Il est étonnant de constater que peu de gens l’ont les ont lus. Vous savez, si on doit éduquer des personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’est la colonisation ou qui ne connaissent pas les pensionnats indiens ou qui ne savent pas grand-chose de l’histoire canadienne… et bien… Chaque fois que des personnes viennent vers nous, on doit les éduquer sur notre réalité, sur notre propre histoire, notre propre culture. Et ça, c’est épuisant. Il y a beaucoup de petites choses à faire, mais je pense que le plus simple et le plus facilement accessible, c’est de continuer avec la Commission de vérité et de réconciliation… ces actions sont facilement accessibles en ligne.
Et il y a des actions en santé. Je pense que beaucoup d’auto-éducation pourrait être faite, que chaque personne prenne le temps de s’éduquer. Quand je dis « vous », je parle du personnel de santé. Oui, en quelque sorte, il faut lire un peu à ce sujet. Je pense que ce serait un bon premier pas. Pas seulement une première étape, mais une grande étape.
Cela conclut notre entretien avec Laverne Gervais, éducatrice en santé sexuelle, le premier entretien de notre série sur la syphilis et la santé publique. Produit par le Centre de collaboration nationale sur les maladies infectieuses, publiés en partenariat avec le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, ce contenu a été rendu possible grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada. Notez que les opinions qui y sont exprimées ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence.
L’organisation hôte du CCNMI est l’Université du Manitoba. Visitez ccnmi.ca pour en savoir davantage.